Damien Butin
ENTRETIEN AVEC... DAMIEN BUTIN
Damien BUTIN (ITIAPE 20, Promo 2008), Directeur de la stratégie et maîtrise d’ouvrage du patrimoine naturel à Bordeaux Métropole) a publié en mai 2024 « POUR UNE VILLE VERTE ET DURABLE » aux Editions Berger-Levrault. Dans cet ouvrage, il partage sa vision sur la place de l’écologie et du paysage dans une métropole, à l’heure du changement climatique et des nouveaux défis urbains qui s’annoncent. L’occasion pour l’AIISA de rencontrer un ingénieur passionné au service d’une grande métropole depuis plus de 15 ans.
AIISA - A la rentrée, nous avons appris que Bordeaux est devenue la 6ème ville la plus attractive au monde…
DB - Bien que nous ne connaissions pas les critères de notation de cette étude, on ne peut que s’en réjouir ! J’y vois l’addition des politiques publiques depuis 10 ans. La ville était alors très ‘minérale’, et Bordeaux a su prendre le virage du verdissement, tout comme beaucoup d’autres villes en France.
En quoi contribues-tu à cette politique publique ?
J’y travaille depuis 15 ans – soit depuis la fin de mes études. J’ai participé dès l’origine à l’aménagement des quais rive droite : les quais rive gauche et le miroir d’eau étaient déjà en place. L’objectif était de créer un grand parc urbain qui dépassait les frontières de la ville de Bordeaux. A présent, il y a une promenade verte : une balade de quai à quai est possible en traversant la Garonne par ses 2 ponts.
Dans ton ouvrage, tu évoques l’axe santé publique intriquée dans la politique des espaces verts. Peux-tu préciser cette relation ?
Voici 10 ans, l’articulation espaces verts-santé publique n’était pas évidente : ces 2 politiques publiques étaient distinctes. Ce lien s’est progressivement installé à la suite de plusieurs études allemandes et espagnoles qui ont montré que les habitants vivant à proximité d’espaces verts ou les traversant chaque jour étaient moins sujets à des problèmes psychologiques, cardiovasculaires… C’était le signe d’une addition de bienfaits dus aux espaces verts : tranquillité de l’esprit, détente, pratique du sport…. A Bordeaux, les terrains sportifs de taille réduite s’insèrent dans les parcs et jardins : c’est ainsi qu’on fait « cohabiter » différents usages dans un parc.
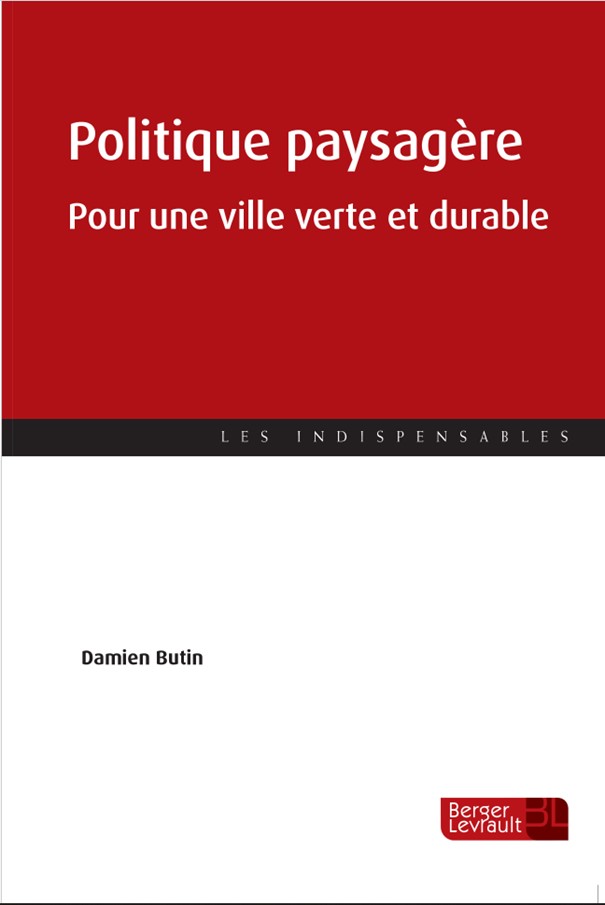
La végétalisation des bâtiments : Est-ce un « gadget » ou au contraire une tendance durable ?
Cette végétalisation s’inscrit dans la durée. Les grandes villes sont devenues des îlots de chaleur, et la végétalisation fait partie des solutions pour y parer. Ainsi nous végétalisons les rues en supprimant des places de parking, et en désimperméabilisant la chaussée ; des permis de végétalisation de façade sont accordés aux particuliers et aux entreprises…D’autres avantages ressortent de cette végétalisation : maintenir la biodiversité, donner aux habitants un cadre de vie plus agréable, et rendre la ville plus respirable.
Quel est ton avis sur les fermes urbaines ?
On peut en avoir 2 lectures : la première aborde la ferme en tant que support pédagogique : Cela permet de faire connaitre, de sensibiliser et d’accompagner des changements : on parle de ‘quartiers du goût’ avec des projets pédagogiques à la clé. La seconde évoque la possibilité de nourrir les habitants en partie grâce aux produits de ces fermes.
En réalité, prendre possession de ces espaces aménagés présente un certain nombre de difficultés, pour des problèmes d’incivisme, de pollution des terres urbaines notamment, sans compter la question de la pérennité économique de ce modèle. Aussi je vois plus ces ‘fermes urbaines’ comme un support pédagogique que comme un ‘business’.
Quelle différence vois-tu entre l’approche paysagère publique et privée ?
Il existe une rupture de vision entre ces 2 approches : Le privé répond à une demande « one shot », tout en étant garant des règles de l’art pour que le rendu soit pérenne.
Pour une collectivité, le maître d’ouvrage doit imaginer des espaces en harmonie avec l’environnement immédiat, en prenant également en compte qu’un arbre vivra au moins 40 ans. Un parc est donc imaginé avec des arbres de 40-50 ans. Bien sûr, il sera nécessaire -face aux évolutions liées aux usages - de compenser l’action du temps, voire de réaménager l’espace à partir de l’ossature du jardin.
Avec le réchauffement climatique, nous sommes face à des évolutions permanentes, des canicules ou des épisodes pluvieux prolongés. Alors à nous de prévoir des aménagements plus résilients face aux stress hydriques et aux périodes caniculaires.
Quand as-tu commencé à ressentir les impacts du changement climatique dans ton ‘environnement’ professionnel ?
On s’en est rendu compte depuis une petite dizaine d’années. On a commencé à voir des arbres ou le sol attaqués par des insectes et des parasites jusqu’à présent inconnus dans nos régions. Et puis, face à une augmentation de l’amplitude thermique ou de stress hydriques, on a constaté un comportement différent des arbres et une mortalité inexpliquée de certaines plantes. Ces 2 phénomènes sont liés : les parasites affaiblissent les arbres, ce qui les fait décliner plus vite lors de coups de chaud.
Comment y faire face ?
Certaines espèces, qui ne sont plus aptes à répondre à terme aux enjeux, sont à présent bannies. Cela nous amène à changer de logiciel : on teste des nouvelles espèces avec un droit à l’erreur.
Pour réduire le risque d’une attaque parasitaire par exemple les plantations sont diversifiées par espèce et par strate – arborée, herbacée et arbustive - afin d’absorber le stress hydrique ou le trop plein d’eau.
Et va-t-on retrouver dans nos étals du « miel de ville » ?
Bonne question ! Dans une politique paysagère, les insectes sont complètement intégrés à la réflexion. On a développé une démarche de réintroduction d’espèces locales souvent riches en production de nectar afin de recréer des écosystèmes, et être ainsi favorable à la biodiversité faunistique et végétale qui s’autoalimentent.
Aujourd’hui, on peut imaginer que très rapidement on pourra produire plus de miel, sachant que le miel de ville est meilleur que le miel de campagne (sans les pesticides qu’on retrouve à la campagne).
Les Amérindiens décidaient en fonction de l’impact de leurs choix sur les 7 générations à venir. Il semble que les choix de notre société se font plutôt sur les 7 années à venir…
Pour moi, cette immédiateté s’est construite face à des impératifs successifs au lendemain de la seconde guerre mondiale, pour loger rapidement et efficacement les habitants sans se préoccuper des enjeux climatiques et sociaux, et puis les logiques sont devenues plus ‘artistiques’ avec la signature de grands urbanistes. On a fini par perdre l’essentiel, à savoir que chaque ville se développe dans des environnements où la nature a été présente avant nous. Nous avons désormais conscience qu’on doit la réintroduire, ce qui amène à changer de raisonnement (développement durable, réutilisation de matériaux via recyclerie…).
Et à l’inverse, y a-t-il des excès de végétalisation dont il serait nécessaire de se prémunir ?
Pour être honnête, arriver à une outrance de vert va prendre du temps! La métamorphose ne sera vraiment significative que dans 10 ou 20 ans selon les territoires. Le véritable enjeu sera de voir comment les collectivités vont gérer cette végétation, afin qu’elle puisse s’inscrire dans le temps : nous n’aurons pas d’armées de jardiniers !...

Avec ton expérience, que pourrais-tu dire à des jeunes diplômés pour les motiver à rejoindre une collectivité ?
Si on veut faire bouger les territoires, la meilleure voie, c’est d’entrer dans une collectivité, car nous avons des compétences sur lesquelles les élus s’appuient. On peut ainsi orienter et décider des projections sur le territoire, ce qui est très riche, car cela va au-delà d’une commande ponctuelle. Cette vision stratégique du territoire qu’on accompagne dans l’intérêt général, je trouve cela non seulement noble en termes de valeurs mais aussi lourd de sens. A titre personnel, j’ai l’impression d’être utile et de participer à une chaîne de vie : un espace vert, c’est un espace de détente, on y rigole, on y boit un verre…, même si les missions ont complètement évolué. A Bordeaux par exemple, on travaille à présent pleinement sur la prévention des inondations, parce que la Garonne est « un ogre qui dort ». Donc on aura à faire face à 2 enjeux exaltants : apporter un cadre de vie sympa mais aussi sécuriser nos concitoyens.
Quels conseils donner à un ingénieur qui arrive sur le marché de l’emploi ?
N’hésitez pas à oser, sans a priori ni certitudes : vous avez le bagage technique, l’envie, allez-y !... Soyez innovants.
Dans ce monde en mutation, on se doit d’apporter un regard différent sur les pratiques, de se projeter avec des contraintes et des enjeux nouveaux…
Damien, merci pour ta vision et ton enthousiasme...
Février 2025 - propos recueillis par Emmanuel Banon



